 Se laisser conduire par une vague imaginaire qui vous transporte ailleurs.
Se laisser conduire par une vague imaginaire qui vous transporte ailleurs.
Jour d’hiver,
Plat, humide, ciel blanc grisaille embrumé,
Un jour gris, journée métal.
Me voilà au pied de la Tour Eiffel, ravie. Ses couleurs s’accordent au temps, ses contours structurent l’espace, le gris du jour s’adoucit face à son imposante présence.
Mais je pourrais tout aussi bien faire un détour plus au sud, y chercher un peu de chaleur. Madrid, les images affluent, celles de mon dernier séjour dans la capitale espagnole. Je déambule dans les rues animées, sur des avenues larges et généreuses, prends place sur une terrasse. Espace doré, lumière de miel.
Mon regard se pose sur un bouquet de mimosas devant moi sur la table. Etincelles duveteuses. Je suis à Nice dans le jardinet des grands parents. Le mimosa embaume l’air. Douceur de ces moments heureux d’enfance, palpables, si proches tout à coup, et tout prêts à s’évanouir dans le passé du temps, comme un rêve.
Souvent, je change de lieu.
Une impression, une sensation et me voilà au croisement de deux rues.
Le jeu consiste à repérer les lieux , les nommer, tirer le fil qui me relie à eux, alors que je suis là, dans le présent, mais ailleurs aussi.
Promenades dans les méandres de ma mémoire.
J’aime ces balades imaginaires.
Elles prennent vie dans les fissures du temps, dans les brèches d’une journée maussade, ne durent qu’un instant , comme un flash, pétillent de malice et de cette connivence avec mon histoire.
Catherine COHEN
Paris, le 11 février 2025
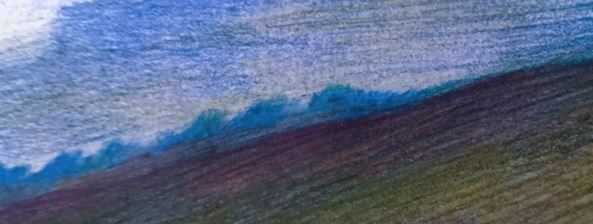

 Elle a tout d’une grande
Elle a tout d’une grande


 Rêver de bleu
Rêver de bleu Se laisser conduire par une vague imaginaire qui vous transporte ailleurs.
Se laisser conduire par une vague imaginaire qui vous transporte ailleurs.